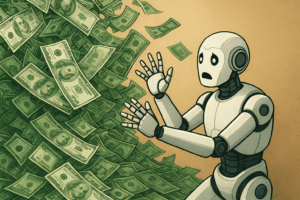
1. Une explosion des investissements, peu de retours
Au cours de l’année 2025, les entreprises ont connu une véritable explosion des investissements dans l’IA générative (GenAI). Selon diverses sources, ces investissements oscillent entre 30 et 40 milliards de dollars, certains rapports allant même jusqu’à mentionner plus de 44 milliards engloutis rien qu’au premier semestre de l’année. Toutefois, cette frénésie d’investissement contraste fortement avec les résultats obtenus : malgré ces sommes colossales, près de 95 % des projets GenAI n’ont abouti à aucun retour sur investissement tangible ou mesurable. Cette situation met en lumière un écart grandissant entre l’enthousiasme des dirigeants pour l’innovation technologique et la réalité opérationnelle des entreprises, où les retombées concrètes se font encore largement attendre.
2. Le « GenAI Divide » : seuls quelques-uns tirent leur épingle du jeu
Si l’on observe de plus près, seuls 5 % des projets pilotes d’IA parviennent réellement à générer de la valeur significative, certains se chiffrant même en millions pour les rares entreprises qui maîtrisent l’intégration de ces technologies. Pour la vaste majorité, cependant, l’impact sur la performance ou les résultats financiers demeure négligeable, traduisant une fracture grandissante entre les organisations pionnières et toutes les autres. Ce phénomène, désormais désigné sous l’expression « GenAI Divide », met en exergue une inégalité structurelle : quelques entreprises parviennent à transformer les investissements en bénéfices concrets, tandis que la grande masse peine à dépasser le stade expérimental, accumulant les initiatives sans véritable retour. Ainsi, le paysage de l’IA en entreprise en 2025 se dessine comme un terrain où seuls quelques acteurs tirent pleinement profit du potentiel de l’intelligence artificielle, laissant les autres à la traîne, en proie à l’incertitude et à la frustration face à des promesses encore largement non tenues.
3. Qu’est-ce qui freine l’impact de l’IA en entreprise ?
Le rapport met particulièrement l’accent sur un frein fondamental à l’impact de l’IA en entreprise : il ne s’agit ni d’un manque de compétences techniques, ni d’un déficit d’infrastructures, ni même de contraintes réglementaires. Le véritable obstacle réside dans la stagnation des systèmes eux-mêmes. La majorité des modèles déployés en entreprise fonctionnent encore en vase clos, sans intégration systématique des retours d’expérience issus du terrain. En l’absence de mécanismes de feedback continus, ces modèles ne s’améliorent pas et finissent rapidement par être déconnectés des besoins réels des métiers qu’ils sont censés servir.
Cette incapacité à évoluer en temps réel, à apprendre des utilisateurs et à ajuster leur fonctionnement aux changements opérationnels, condamne de nombreux projets d’IA à l’obsolescence bien avant de pouvoir démontrer une valeur concrète. Ainsi, même les investissements les plus ambitieux se heurtent à une barrière organisationnelle : tant que les entreprises n’auront pas instauré une culture de l’apprentissage dynamique pour leurs systèmes d’IA, la majorité des initiatives restera au stade expérimental. L’enjeu majeur devient alors de créer une véritable boucle de rétroaction entre l’utilisateur final et la technologie, afin d’assurer une adaptation constante et un alignement durable avec la réalité du terrain.
4. L’ombre prospère de l’IA “informelle”
L’avènement de l’IA “informelle” constitue une évolution majeure et souvent sous-estimée dans la dynamique des organisations. Au-delà des déploiements officiels de solutions d’IA générative, un écosystème parallèle se développe : alors que seulement 40 % des entreprises disposent d’une licence formelle pour un grand modèle de langage (LLM), une écrasante majorité des employés—plus de 90 %—recourent régulièrement à des outils d’IA grand public tels que ChatGPT ou Claude dans leur environnement de travail, souvent hors du cadre officiel et parfois même à l’insu des équipes informatiques.
Cette utilisation souterraine révèle non seulement l’agilité des salarié·es à s’approprier des technologies innovantes, mais aussi les lacunes des politiques internes et des stratégies de gouvernance de l’IA. Sans encadrement adéquat, l’IA “informelle” expose les entreprises à des risques accrus en matière de sécurité des données, de confidentialité et de conformité réglementaire. En outre, l’absence de visibilité sur ces usages empêche la capitalisation sur les idées novatrices ou les gains de productivité générés en dehors des circuits traditionnels.
Ce phénomène met en lumière un paradoxe : alors même que les directions investissent massivement dans des projets structurés, l’essentiel de la valeur et des usages quotidiens naît spontanément, guidé par l’initiative individuelle et la recherche d’efficacité opérationnelle. Pour combler ce fossé, il devient crucial pour les entreprises de reconnaître, de canaliser et d’intégrer ces pratiques informelles, en proposant un cadre souple mais sécurisé qui encourage l’innovation tout en protégeant les actifs stratégiques de l’organisation.
5. Impact sur les marchés financiers
La publication de ce rapport a eu un impact immédiat et sensible sur les marchés financiers, révélant une nervosité palpable parmi les investisseurs. Face aux conclusions mettant en lumière le faible taux de réussite des initiatives en intelligence artificielle, nombre d’acteurs ont préféré jouer la prudence : on a ainsi observé une vague de liquidation des actions associées à l’IA, avec des sociétés emblématiques comme Palantir enregistrant une baisse de 3,6 %, et Nvidia une diminution de 1 %. Ce repli illustre la crainte de voir se former une bulle technologique, à l’image de celle qui avait secoué le Nasdaq au tournant des années 2000.
Cette inquiétude ne date pas d’hier. Plusieurs voix influentes du secteur, dont Sam Altman d’OpenAI, avaient déjà alerté contre une surévaluation des startups spécialisées dans l’IA, estimant qu’une partie de l’enthousiasme reposait davantage sur des promesses que sur des résultats tangibles. Les investisseurs, désormais plus attentifs aux signaux du terrain et aux analyses critiques, s’interrogent sur la pérennité des valorisations et sur la solidité des modèles économiques bâtis autour de l’intelligence artificielle.
En somme, loin de constituer uniquement une révolution technologique, l’émergence de l’IA générative provoque également des remous financiers : elle met à l’épreuve la capacité des marchés à discerner les opportunités réelles des engouements passagers, et rappelle que la valeur durable ne peut reposer que sur des usages concrets et des bénéfices démontrés.
6. Perspectives d’avenir et recommandations
- Des écarts sectoriels prononcés dans l’adoption de l’IA : Selon une récente étude menée par Qlik au Royaume-Uni, l’impact de l’intelligence artificielle demeure très variable selon les secteurs d’activité. Tandis que les domaines de l’informatique et de la cybersécurité affichent un taux impressionnant de 81 % de résultats tangibles attribués à l’IA, d’autres secteurs comme les ressources humaines (37 %) ou la finance (30 %) peinent à en tirer des bénéfices directs et mesurables (source : TechRadar). De manière globale, seule une minorité des organisations—11 %—déclare que la majorité de ses initiatives en intelligence artificielle apportent des retombées concrètes. À l’inverse, 44 % des répondant·es soulignent un écart évident entre les bénéfices escomptés et les gains réellement observés, mettant en lumière la nécessité d’une approche beaucoup plus ciblée et ajustée aux réalités opérationnelles de chaque secteur.
- L’importance du leadership dans l’intégration de l’IA : Les résultats d’une enquête réalisée par Gallup montrent que le leadership joue un rôle déterminant dans la diffusion des usages de l’IA au sein des organisations. En effet, 33 % des gestionnaires de gestionnaires déclarent utiliser l’intelligence artificielle de façon régulière, alors que ce chiffre tombe à 16 % chez les contributeur·rices individuels. Cette différence s’explique principalement par l’absence de cas d’usage clairs et partagés au sein des équipes, ce qui freine l’adoption généralisée. L’étude révèle également que lorsque la direction communique de manière transparente et propose un plan d’intégration structuré pour l’IA, les employé·es se sentent trois fois plus prêt·es à utiliser et à s’approprier ces nouvelles technologies (source : Business Insider). Cela souligne l’importance d’une vision portée par le haut pour accompagner, sécuriser et accélérer la transition vers des pratiques innovantes et efficaces.
Conclusion
Le rapport MIT “The GenAI Divide: State of AI in Business 2025” met en lumière un paradoxe frappant : malgré des investissements massifs, 95 % des projets IA restent sans retour mesurable. Le véritable frein serait non technique, mais organisationnel : absence de feedback intégré, incapacité des modèles à apprendre et s’adapter.
Meta a d’ailleurs gelé les embauches dans sa division dédiée à l’intelligence artificielle la semaine dernière, dans le cadre d’une vaste réorganisation interne.
Cette décision intervient après une phase de recrutement intensif accompagnée de salaires très élevés : plus de 50 ingénieurs et chercheurs en IA ont été recrutés, y compris de grands noms provenant de concurrents comme OpenAI, Google ou Anthropic. Le gel concerne également les transferts internes, sauf pour les cas jugés « critiques pour l’activité » et validés par le directeur IA, Alexandr Wang. Meta présente cette mesure comme une étape de « planification organisationnelle de base » destinée à structurer ses efforts en matière de superintelligence après une phase de croissance rapide.


